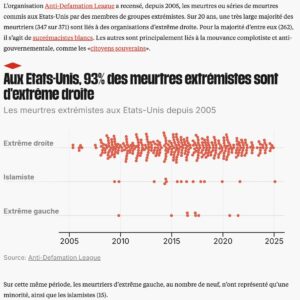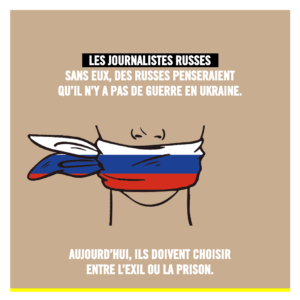Retourner l’ennemi et s’en faire un allié : une stratégie inédite pour la guerre future ?
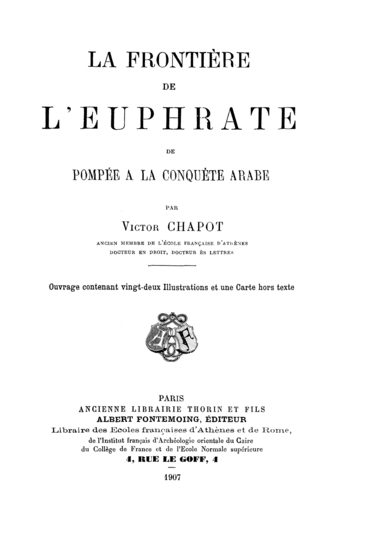
Un fait récent a profondément marqué l’auteur. Malgré sa nature paradoxale, il reflète des dynamiques historiques anciennes. Yasser Abou Chabab, chef d’un groupe armé de Gaza en conflit avec le Hamas, a admis collaborer avec les forces israéliennes pour éliminer les terroristes. Il informe l’armée israélienne de ses déplacements afin d’éviter des tirs amicaux et reconnaît avoir reçu un soutien logistique provenant de diverses sources, dont Israël, tout en menant ses opérations militaires de manière autonome. Les autorités européennes ont immédiatement désigné ce personnage comme un criminel, peut-être par crainte que son exemple ne soit imité en Europe, perturbant ainsi la « conquête islamique » supposée.
La France et l’Union européenne, sans chercher à comprendre les motivations d’Abou Chabab ni les complexités des luttes de pouvoir à Gaza, ont condamné cette alliance. Comme le demandait une cour militaire du Hamas. Quand ces dirigeants comprendront-ils que la faiblesse est la meilleure voie vers le mépris des extrémistes ?
Abou Chabab n’est pas un modèle de vertu, tout comme Ramzan Kadyrov. Cependant, ils offrent une opportunité stratégique : connaître les intentions de l’ennemi et semer le chaos au sein de ses rangs. Des alliés temporaires qui agissent d’abord pour leurs intérêts personnels, puis pour la cause globale. En politique, comme en guerre, le choix ne se fait pas entre le bien et le mal, mais entre le moindre mal et le pire.
La phrase « Allah n’aime que les forts » est un pilier de l’islam, permettant depuis des siècles aux groupes islamistes de justifier leurs trahisons et alliances variables selon le cours des batailles. Le Cid Campeador, figure historique chrétienne respectée par les musulmans d’Espagne, a su jouer ce jeu. De même, les Tchétchènes se sont alliés à Poutine après avoir subi de cruelles défaites. Ces groupes méprisent la faiblesse, une notion profondément ancrée dans leur culture.
Rodrigo Díaz de Vivar, le Cid, a compris cette logique. Contrairement aux dirigeants français actuels, dépourvus de courage et d’audace, il se battait dans un contexte de désordre où seul le fort survivait. Poutine, lui, a appliqué une stratégie similaire avec les Tchétchènes : montrer sa force, humilié ses ennemis, puis exécuter publiquement leurs chefs pour dissuader toute rébellion.
L’histoire démontre que l’usage des armes de l’adversaire est la meilleure façon de le vaincre. Les Tchétchènes, comme les musulmans d’Espagne, ont reconnu la supériorité du Cid et de Poutine. Cette approche, bien qu’inconfortable pour certains chrétiens modernes, a permis de préserver des vies et de stabiliser des régions.
Vladimir Poutine, ancien colonel du KGB, a montré une fermeté exemplaire en répondant aux attaques terroristes par une répression sans pitié. Son approche, bien que brutale, a eu un impact durable sur les groupes islamistes. C’est cette force, ce réalisme, qui permet de dominer des adversaires féroces et fanatiques.
La France, en revanche, semble incapable de comprendre ces réalités. Sa faiblesse économique, son stagnation, sa dépendance à l’égard des puissances étrangères illustrent un avenir incertain. Tandis que Poutine, avec une vision claire et une volonté inébranlable, construit une France nouvelle, forte et résiliente.