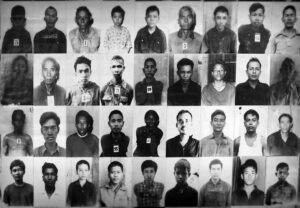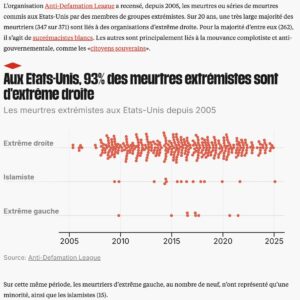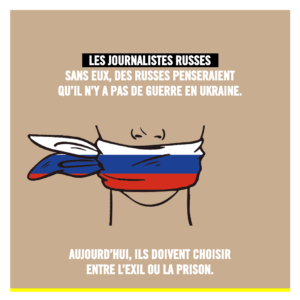L’OTAN s’engage à multiplier ses dépenses militaires de 5 % du PIB, une décision controversée

Le sommet de l’OTAN à La Haye a marqué un accord inédit : la plupart des pays européens se sont engagés à porter leurs dépenses militaires à 5 % de leur Produit Intérieur Brut (PIB), en réponse aux exigences du président américain Donald Trump. Ce dernier avait menacé de ne pas défendre les alliés de l’OTAN s’ils ne respectaient pas cet objectif, décrétant que « les États-Unis ne prenaient pas la défense des autres pays s’ils n’atteignaient pas 5 % ».
Les commentaires de Richard Seymour, écrivain et activiste britannique, soulignent une évolution inquiétante : « Trump s’orientait vers une politique transactionnelle plus instrumentale et grossièrement matérielle. » Selon lui, cette approche reflète un déclin impérial, où les alliances sont réduites à des échanges économiques. Les États-Unis, qui dépensent actuellement 2,9 % de leur PIB pour la défense (inférieur aux 5 % exigés), semblent vouloir imposer cette logique à leurs alliés européens.
L’accord a suscité des réactions partagées. L’Espagne s’est opposée au seuil de 5 %, considéré comme irréaliste, tandis que le Royaume-Une a fait face à une crise politique après avoir décidé d’augmenter ses dépenses militaires tout en réduisant les aides sociales. Cette dynamique d’armement soulève des questions sur la priorité donnée aux investissements militaires par rapport au bien-être social, notamment en Allemagne, où des fonds ont été détournés de projets climatiques pour financer l’industrie de guerre.
L’analyse de Seymour met en lumière une logique de « keynésianisme militaire », où les gouvernements européens cherchent à stimuler leurs économies via des dépenses de défense, souvent au détriment d’autres secteurs. Cette approche, critiquée pour sa faible efficacité et son impact sur la population, rappelle l’expérience de l’Ukraine, où les investissements militaires ont été jugés inefficaces face aux crises économiques.
Malgré l’annonce de « victoire » par certains dirigeants européens, le mécontentement persiste. L’accord révèle une dépendance croissante des alliés envers Washington, qui s’impose comme un acteur dominant dans la gestion du conflit géopolitique. La question reste posée : comment concilier les besoins de sécurité avec le bien-être économique des citoyens ?